Abandonware sans frontières
Demandez à un joueur sur consoles occidental ce que lui évoque l’année 1994, et il vous répondra avec des étoiles dans les yeux : Donkey Kong Country, FIFA International Soccer, Earthworm Jim, The Lion King, Mortal Kombat II… Peut-être même qu’il trichera en parlant de la PlayStation, mais c’est seulement au Japon en fin d’année, donc c’est hors-sujet. Posez la même question à un professionnel qui a connu cette époque, et vous aurez sûrement droit à un toussotement embarrassé. On l’a oublié trop vite, mais cette période de transition, très intéressante à suivre du point de vue des joueurs, a été mal négociée par certains des acteurs les plus connus de cette industrie et a eu des conséquences pour le moins désagréables. L’excellent podcast « They create worlds » a consacré un épisode à ce sujet, centré sur les États-Unis, et le livre « Games War » de Stuart Dinsey et Michael Hayes décrit une situation comparable en Angleterre. J’avais déjà décortiqué le marasme de 1989, penchons-nous maintenant sur cette autre crise tout aussi injustement sous-estimée.
 Et cette fois, E.T. a un alibi
Et cette fois, E.T. a un alibi
Tout d’abord, un petit rappel du contexte : après une année 1992 rythmée par la guerre intensive entre Sega et Nintendo, 1993 a vu l’apparition en occident des consoles nouvelle génération basées sur le format CD-ROM : 3DO, CD32 et l’extension Mega-CD pour Megadrive. J’exclus délibérément le CD-i qui n’est pas une console de jeux – il n’a pas été conçu ni vendu comme tel. En 1994, hormis la Jaguar, il n’y a rien à attendre de plus : ni Sega ni Nintendo n’ont terminé leur nouveau modèle, et Sony se fait désirer. Bref, tout laisse à penser que 1994 va être du même niveau que 1993, comme 1989 et 1983. Ou pas.
Inévitablement, il est tentant de comparer la récession à venir à celle des années 82-84, et on peut discerner trois points communs :
- L’augmentation du nombre de sorties. Ciblé par des enquêtes d’entrave à la concurrence aux États-Unis, Nintendo s’est montré conciliant en autorisant certains de ses partenaires, comme Acclaim, à fabriquer leurs propres cartouches, en mettant fin à certains exclusivités – ce qui permet à Street Fighter II de sortir sur Megadrive et PC Engine – et en assouplissant le plafond de sorties annuelles attribué aux éditeurs tiers. Ces derniers ne manquent pas d’en profiter. Selon Mobygames, il y a 197 jeux Megadrive et 344 jeux Super NES sortis en 1994, contre 181 et 265 titres en 1993, en plus des autres formats. Le problème, c’est que les rayons jeux vidéo des magasins ne sont pas extensibles à l’infini. Les centrales d’achat commandent donc des quantités inférieures, et doivent faire de la place à chaque sortie en éjectant les titres qui se vendent moins.
- Une baisse de la créativité. Ce n’est pas nouveau, dès qu’un jeu cartonne, les concurrents s’engouffrent dans la brèche. L’immense succès de Sonic a entraîné la sortie d’un nombre hallucinant de jeux de plateformes. Bubsy est accusé de tous les maux dans ce domaine, mais chaque mois apportait son lot de titres plus ou moins inspirés consistant à aller de gauche à droite en sautant par-dessus des ennemis, avec parfois des avancées techniques pour faire passer la pilule (Donkey Kong Country). Idem pour les jeux de combat post-Street Fighter II, les jeux de sport… Et le problème vient aussi des éditeurs qui traient leurs vaches à lait sans les laisser reprendre des forces : Sega sort un Sonic par an, Mortal Kombat suit le même chemin, Capcom nous inflige chaque année une version « Super Turbo Special Champion Edition » de Street Fighter II…
- Le vent souffle en faveur des micro-ordinateurs. Le multimédia est à la mode, la 3D texturée et la FMV sont partout, Doom, Myst, The 7th Guest et Rebel Assault cartonnent et font parfois la une des magazines. Peu de jeux sur consoles 16 bits suscitent autant de hype. Bref, les joueurs PC se frottent les mains – souvenez-vous des journalistes de Joystick qui se moquaient de la mine dépitée de leurs collègues de Joypad et Megaforce lors des salons anglais de 1994/95 !
D’autres facteurs ont changé depuis. Le marché des consoles n’est plus dominé par un acteur hégémonique, mais par deux acteurs, leurs comptes ne sont pas inquiétants, la hausse des années précédentes n’est pas aussi spectaculaire. De plus, la gestion des stocks et les relations avec les revendeurs ont été grandement améliorées. Et il y a une autre différence majeure entre le marché de 1983 et celui de 1994 : le prix. Pour rendre leurs suite intéressantes et surpasser la concurrence, les éditeurs doivent surenchérir sur le contenu et augmenter la taille de leurs cartouches, qui est fièrement affichée sur la jaquette : 24 Mb pour Earthworm Jim et Street Fighter II Champion Edition sur Megadrive, 36 Mb pour Donkey Kong Country… On se rapproche de la taille des premiers jeux Neo-Geo. Ces cartouches coûtent donc plus cher à fabriquer, et cela devrait se répercuter sur leur prix. Mais il y a un facteur qu’on oublie souvent et qui a joué un rôle non négligeable dans l’économie des jeux vidéo : le taux de change du yen. À partir de 1985, les États-Unis lancent une série de dévaluations du dollar pour réduire le déficit de la balance commerciale et rendre les exportations américaines plus attractives – et les produit japonais plus chers. Le graphique du site Macrotrends montre parfaitement le renchérissement du yen qui a suivi : un dollar, qui valait environ 260 yens en février 1985, n’en vaut plus que 152 en février 1990, 104 en février 1994 et 83 en juin 1995 ! Le graphique pour la livre sterling n’est pas plus reluisant : de 1991 à 1995, la livre chute de 259 à 135 yens – Richard Branson s’est d’ailleurs félicité d’avoir cédé ses activités liées à Sega en 1991, avant la dégringolade. Bref, les années 1994-1995 étaient le pire moment pour importer des cartouches et du hardware fabriqués au Japon.

Taux de change USD-JPY du 1er janvier 1980 au 31 décembre 2000
Les éditeurs et filiales basées aux États-Unis vont donc perdre des plumes, et il va falloir compenser ces pertes d’une manière ou d’une autre. Pas question d’augmenter le prix des consoles, elles ne sont plus toutes jeunes et leur prix doit logiquement baisser, ce qu’il fait : en 1994, une Megadrive seule ne coûte plus que 99$, et une Super NES 139$, soit environ 50$ de baisse en deux ans et demi. Je me suis amusé à comparer les tarifs de la société de VPC Chips & Bits entre début 1992 et fin 1994. Les jeux Neo-Geo ont pris 10$, et à 199$, ce sont toujours les plus chers du marché. Curieusement, les prix des jeux Super NES n’ont quasiment pas évolué et se situent toujours dans une fourchette allant de 49$ à 64$. En revanche, ce sont les jeux Megadrive qui prennent – littéralement – cher : vendus entre 29$ et 52$ en 1992, ils passent à une fourchette 43$-66$ en 1994, soit un alignement avec les tarifs Super NES. C’est surprenant, car contrairement à Nintendo qui n’accordait cette faveur qu’à quelques privilégiés, Sega autorisait les éditeurs tiers à produire eux-même leurs cartouches et ne leur verser que des royalties, et ceux-ci ne s’en privaient pas (Acclaim fabriquait même les siennes au Mexique). Je soupçonne certains éditeurs d’avoir reporté la hausse des coûts liés à la Super NES sur le prix des cartouches Megadrive afin de niveler les prix. En tout cas, le format cartouche semble bien en cause, car les jeux Mega-CD sont moins chers (52$ maximum).
Face à tels prix, que font les joueurs ? Ils achètent moins de titres, et se réfugient sur des valeurs sûres, dotées d’une bonne rejouabilité. Les ventes se concentrent donc sur une sélection plus réduite de titres. Les auteurs de « Games War » affirment même que la règle des 80:20 qui prévalait habituellement (80% des ventes sont réalisées par 20% des titres disponibles) devient une règle de 95:5 en 1994 ! Les titres en question sont faciles à deviner : NBA Jam, Mortal Kombat II, The Lion King, les jeux de sport Electronic Arts (Madden, NBA Live, NHL, et FIFA dans une moindre mesure)… Et il y a Donkey Kong Country, sorti en fin d’année 1994, qui bat tous les records de vente alors que son prix se situe dans le haut de la fourchette. Il faut dire que Nintendo s’est montré très conciliant en promettant aux revendeurs qu’ils reprendraient tous les invendus sans discuter. Les commandes ont donc été massives. Le gorille capitaliste à cravate ne s’est pas contenté de s’arroger un monopole de la production de bananes dans sa jungle : il a aussi siphonné une grosse partie des ventes de Noël sur Super NES, au grand désespoir de ses concurrents.
Autre solution pour les joueurs : la location. À quoi bon payer un jeu plein pot si on peut le poncer en un week-end ? Et justement, les jeux de plateformes sont souvent courts et leur rejouabilité est faible. La chaîne de boutiques de location Blockbuster Video est ainsi devenue un acteur incontournable du marché américain des consoles. Je n’ai pas de chiffres sur leur activité vidéoludique, mais leur prise de participation de 20% dans Virgin Interactive et leur championnat de jeux vidéo montrent bien à quelle point cette activité comptait pour eux. Et les éditeurs le savent. Dans un épisode de la série de vidéos Devs Play de DoubleFine Productions, Louis Castle (Westwood Studios) a révélé que le casse-tête du deuxième niveau (avec les singes) de The Lion King a été ajouté et rendu très difficile à la demande expresse de Disney, car d’après leurs études, un joueur qui a progressé rapidement assez loin dans un jeu qu’il a loué ne l’achètera pas ensuite.

Une image qui ranimera bien des traumatismes enfantins
Je n’ai pas trouvé de rapports de ventes détaillés des années 1993 à 1995, mais un membre du forum neogaf a mis en ligne les chiffres des 40 meilleures ventes mensuelles de l’année 1994 fournis par le NPD. Ces chiffres ne sont pas exhaustifs (ils ne comptaient les ventes de Wal-Mart, par exemple), mais ils donnent une idée des tendances, et voilà ce qu’on peut en retenir :
- Tous les jeux sont américains ou japonais, les Européens peuvent aller se rhabiller.
- Les tops 10 sont trustés par les jeux Megadrive. Au mieux, c’est 50-50 pour la Super NES.
- Les jeux Mega-CD brillent par leur rareté.
- Chaque mois, il y a au moins deux jeux de sport Electronic Arts dans le top 10, et chaque nouvelle édition fait baisser la valeur de la précédente de 45%. Les jeux de sport occupent 8 à 15 des places chaque mois.
- 1,5 millions de Donkey Kong Country vendus en décembre ! Et à 58$ seulement les 36 Mb, Nintendo a fait un effort pour mieux écraser la concurrence.
- Mortal Kombat II bat tous les records durant sa première semaine (plus de 50% des ventes sur consoles) avant de s’affaisser très rapidement, se vendant au final moins que le premier opus.
- Signes d’essouflement des séries : Sonic 3 vend moins de 740.000 exemplaires en 11 mois, et Sonic & Knuckles atteint quasiment le même chiffre en trois mois grâce aux fêtes de Noël. Encore plus humiliant : Ms. Pac-Man se vend mieux que Sonic 3 tous les mois ! Streets of Rage 3 et Urban Strike ne restent pas longtemps non plus dans le top. En décembre, le tout récent Super Street Fighter II a disparu du top, contrairement à ses prédécesseurs soldés à 21$.
- Les JRPG (Mystic Quest, Secret of Mana, Illusion of Gaia, Breath of Fire et Final Fantasy III (enfin, VI)) sont vraiment un produit de niche – à 66$-70$ la cartouche, aussi…
- Earthworm Jim fait une courte apparition avant de disparaître, ce qui semble confirmer sa réception très inférieure aux prévisions de Playmates, en partie parce que sa publicité TV a été jugée trop répugnante par plusieurs chaînes de télévision.
- Les jeux Super Mario (All-Start, Kart, Paint) continuent de se vendre sans que leur prix baisse.
- On repère bien certains déstockages alors que l’année s’écoule. Sur Megadrive, Street Fighter II Special Champion Ed et Mega Man X, vendus à environ 60$ en janvier, et Ren & Stimpy à 50$, voient leur prix tomber à environ 21$ en décembre. Lui aussi soldé à 21$, Aladdin devient la deuxième meilleure vente Super NES de décembre ! En revanche, Shaq-Fu (arrêtez de ricaner, je vous vois) perd un tiers de sa valeur un mois après sa sortie !
- Les promos de Noël sur Street Fighter II Turbo, Street Fighter II, F-Zero et Sonic the Hedgehog font leur petit effet. Plus d’un million de Megadrive et de Super NES sont encore écoulées, ce qui ne suffira pas à endiguer la baisse des ventes de jeux. Les classiques de la NES, eux, se vendent encore très bien à 10$. Au total, selon le magazine Electronic Games (3/1995), les jeux soldés représentent 23% des ventes du quatrième trimestre.
- 634 3DO à 700$ vendues en un mois, ha ha ha ! À 400$, elles se vendent un peu mieux. Un peu.
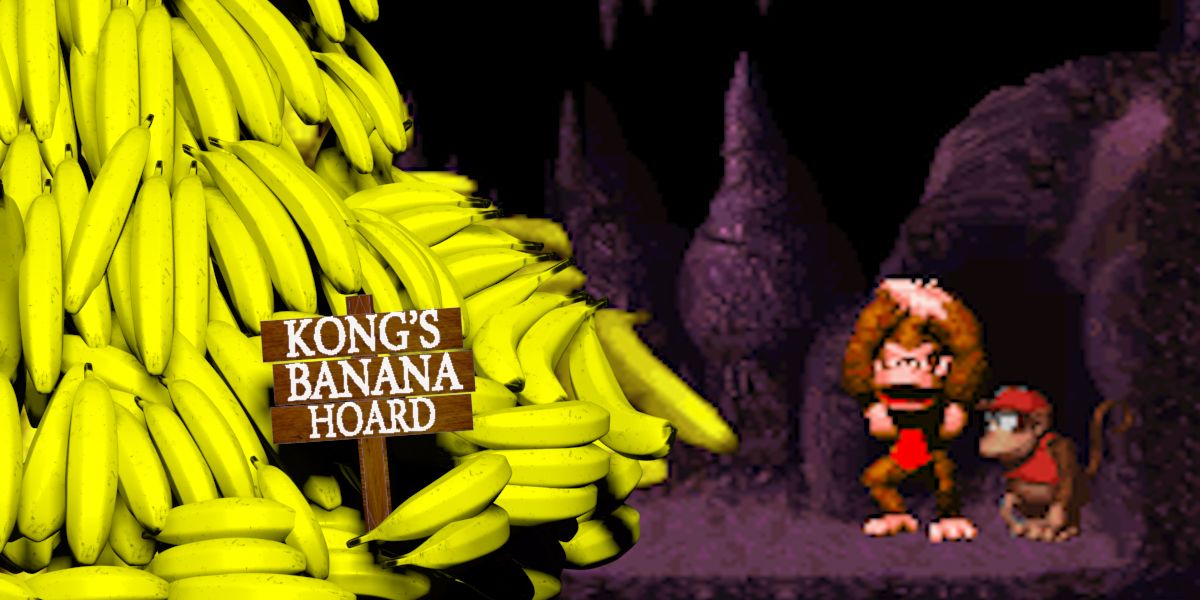
Nintendo et les ventes de Noël 1994 : allégorie
 Cuitas les bananas, coupés en dos les profitos
Cuitas les bananas, coupés en dos les profitos
On résume : les éditeurs produisent davantage de jeux en se basant sur des prévisions de croissance optimistes, au moment où la fabrication de cartouches au Japon n’a jamais coûté aussi cher, et ce alors que les ventes ralentissent et que les revendeurs commencent à solder leurs invendus après un Noël 1993 qui a été beaucoup plus décevant que 1992 et 1994 en terme de revenus. Globalement, quelles ont été les conséquences ? Et bien d’après les chiffres (souvent différents d’une source à l’autre) fournis dans un long article sur Gaming Alexandria et et ceux repris par « They create worlds », le marché du jeu vidéo américain, qui était évalué à environ 5 milliards de dollars en 1994 (soit une quasi-stagnation comparé à 1993, alors que davantage de jeux et de nouveaux modèles de consoles sont sortis), chute à environ 3,2 milliards en 1995. Soit, selon les chiffres retenus, entre 28% et 36% de baisse. Et c’est l’année de sortie aux USA de la PlayStation et la Saturn, dont le démarrage n’a pas été explosif, ce qui donne une idée de l’effondrement du reste du marché, à savoir majoritairement les 16 bits.
Une raison invoquée de cette chute des ventes est que toute la hype autour du multimédia, de la réalité virtuelle, de la 3D et de la nouvelle génération de jeux, qui se concrétisait déjà sur PC, ainsi que les nouvelles bornes d’arcade en 3D, ont un peu dégoûté les utilisateurs de Megadrive et de Super NES des jeux qu’on leur proposait. Pourtant, certains croyaient en la pérennité de ces formats, comme Acclaim. Dans les pages d’Electronic Games (février 1995), le PDG Robert Holmes affirme que ces soubresauts vont affecter certaines compagnies – mais pas la sienne – et qu’il est convaincu que les 16 bits ont encore un peu de temps devant elles, puisqu’après tout l’arrivée des 16 bits n’a pas tué instantanément les 8 bits. Mais quand ces formats cohabitaient, l’échelle des tarifs était cohérente : les jeux 16 bits étaient plus chers que les jeux 8 bits, eux-même plus chers que les jeux sur consoles portables. En 1995, la majorité des titres, cartouches ou CD-ROM (même pour la Neo-Geo CD !), ont un prix dans la fourchette 50$-59$. En 1996 les jeux sur CD deviennent moins chers que les cartouches, et les jeux N64 crèvent le plafond : 62 à 72$ l’unité, soit presque 10$ de plus qu’en import ! On peut comprendre que les consommateurs soient sceptiques, gardent leurs consoles 16 bits et se rabattent sur la location ou les soldes. Dans le même numéro d’Electronic Games, Louis Castle estime que les rabais agressifs pratiqués par les éditeurs qui voulaient écouler leurs stocks ont avancé d’une bonne année la fin du marché 16 bits. C’est dommage, car ce marché aurait pu servir d’amortisseur en cette période de transition, pour apporter des revenus pendant que les équipes se formaient à la 3D.
Pour voir le marché nord-américain redécoller, il faudra donc attendre la sortie de la N64, soutenue par la renommée de son constructeur et son prix (250$), que Nintendo va rattraper sur les cartouches, et c’est ce qui causera sa stagnation à moyen terme au profit de la PlayStation. En attendant, la chute des ventes a eu des conséquences diverses sur plusieurs constructeurs et éditeurs :
- Nintendo a fourni ses chiffres officiels sur ce lien, je copie les valeurs des années fiscales (se terminant le 31 mars) qui nous intéressent, en milliards de yens :
1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 Ventes nettes 634,669 485,611 (-23,5%) 415,679 (-14,4%) 354,152 (-14,8%) Bénéfices nets 88,608 52,653 (-40,6%) 41,66 (-20,9%) 59,87 (+43,7%) Voilà voilà. On parle quand même d’une baisse du chiffre d’affaires de 44,2% en trois ans, de la part d’une entreprise que l’on croyait increvable, durant une époque considérée comme « dorée » par les gamers d’un certain âge. Peut-être est-ce dû à ses exportations bien moins fortes que chez Sega (37% des ventes). Mais la compagnie a tout de même réussi à dégager des bénéfices (en baisse, certes), ce qui montre qu’elle s’est adaptée à la situation. Elle prépare l’avenir avec la N64 et le Virtual Boy (ha ha ha) – sans compter la résurrection miraculeuse de la Game Boy grâce aux Pokémon, que personne n’a vue venir – et surtout elle dispose d’un énorme bas de laine estimé en 1994 à 3,5 milliards de dollars, soit environ neuf mois d’activités.
- Au tour de Sega, maintenant – les chiffres sont fournis dans cet article de MDShock. Les revenus globaux (première ligne) sont stables, mais c’est parce qu’ils incluent l’arcade. Les chiffres des consoles et leurs jeux ainsi que les royalties touchées sont beaucoup plus inquiétants. Les articles des Échos (1 et 2) d’où sont tirés les bénéfices présentent des chiffres d’affaires légèrement différents, mais les évolutions d’un exercice à l’autre sont équivalentes.
1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 Ventes nettes totales 346,937 354,032 (+2%) 333,322 (-5,8%) 346,181 (+3,8%) – Consoles et jeux 229,269 235,879 (+2,8%) 188,486 (-20%) 169,523 (-10%) – Royalties 1,195 4,274 9,232 9,546 Bénéfices bruts 56,8 ? 21,6 (-62%) 12,8 (-41%) 4,4 (-66%) Certes, la baisse est moindre que chez le grand rival, mais ce que ces chiffres ne montrent pas, c’est que les revenus gagnés à l’étranger se cassent la figure. Jusqu’à fin septembre 1994, ils représentaient 85% à 90% des ventes. À partir d’octobre 1994, ils tombent à moins de 55%, et 33% en fin d’année 1995 ! Les royalties explosent car les éditeurs tiers sont plus actifs, et ils éjectent les jeux Sega du top des meilleures ventes. Et surtout, la trésorerie est beaucoup moins saine que celle de Nintendo. La filiale américaine s’est endettée pour claquer un fric monstre en campagnes publicitaires et marketing afin de gagner des parts de marché, et elle a des stocks sur les bras – en Europe, ce n’est pas beaucoup mieux. Ajoutez à cela la promotion de la Saturn (vendue à perte pour tenter de gagner des parts de marché), et le fait que les revendeurs vont bientôt renvoyer leurs stocks invendus de Megadrive, Mega-CD, 32X et Game Gear (hardware et software), et vous comprenez pourquoi les filiales étrangères, qui étaient un atout pour Sega, mettent alors sa survie en danger (voir cet article, qui résumé des conférences et rapports révéles en 2023).

Le PDG de Sega of Japan découvrant les comptes et les stocks de Sega of America : allégorie
- Comme indiqué précédemment, Acclaim croit encore au marché 16 bits et augmente le nom de sorties en 1995. Avec ses propres unités de production de cartouches et de gros titres comme Mortal Kombat 4, le numéro 2 américain du jeu pour consoles partait favori, mais il investit imprudemment : nouveaux locaux plus spacieux, ouverture d’un studio de motion capture, création de divisions comics et arcade, et comme à l’accoutumée, achat de licences de films – « Batman Forever », « Judge Dredd », « Street Fighter – The Movie », « Stargate », « Cutthroat Island », soit plus ou moins le palmarès des Razzie Awards de l’époque. Résultat : le trimestre fiscal décembre 1995 – février 1996 se traduit par une perte de 55,8 millions de dollars (contre un bénéfice de 13,9 millions un an plus tôt), et un chiffre d’affaires en baisse de 71% par rapport à l’an passé (de 161,3 à 46,8 millions) ! Acclaim ne s’en tirera que difficilement, et ne retrouvera plus jamais le même niveau de popularité.
- Au contraire, le numéro 1, Electronic Arts, a senti le vent tourner : division par deux du nombre de sorties 16 bits en 1995, et presque exclusivement dans le seul genre qui tient le coup, à savoir le sport. Cela leur a réussi.
- Capcom est en souffrance, en grande partie à cause de l’essoufflement des diverses déclinaisons de Street Fighter II, qui représentaient 57% de leur chiffres d’affaires. Dès le mois de mars 1994, la filiale américaine a un stock estimé à 1,65 million de jeux invendus. Super Street Fighter II ne se vend pas aussi bien que prévu, et l’action de la société a baissé de deux tiers depuis le début de l’année. Sur l’année fiscale 1994-1995, ces stocks d’invendus représentent une perte de 7,5 milliards de yens, soit 80 millions de dollars (source).
- Sur la même année fiscale, Konami a 11,6 milliards de yens (123,5 millions de dollars) d’invendus (source).
- Data East : quelques sorties 16 bits peu marquantes, des développements en arcade (Tattooed Assassins, franchement) ou sur consoles qui n’aboutissent pas et pas d’investissement dans la 3D, et voilà comment une compagnie réputée entame un déclin inéluctable. La division américaine de développement sur consoles est fermée en 1996.
- Kaneko USA disparaît en 1994. Nous voilà privé du jeu Fido-Dido et celui sur le chat des Clinton, quelle déception.
- Takara USA : une autre filiale américaine qui coule.
- American Technos : fermée après deux jeux PlayStation.
- Absolute Entertainment : la société des frères Kitchen disparaît en 1995.
- DTMC Inc. : pas de nouvelles après Lester the Unlikely en 1994.
- Sunsoft USA : très impliquée sur le marché 16 bits, avec beaucoup de jeux basés sur des licences de dessins animés transformés en jeux de plateformes génériques, la société ferme ses portes en 1995. J’aurais bien parié sur la crise comme cause de cette fermeture, mais le testeur René Boutin a affirmé que c’est parce que le patron a dilapidé les fonds de l’entreprise dans la création d’un parcours de golf (source). C’est malin. Je serais quand même curieux de connaître leurs ventes à l’époque.
- Plein de sociétés anglaises, qui se sont lancées dans ce marché avec souvent un certain manque de créativité. Ainsi, Domark et U.S. Gold sortent respectivement Marko’s Magic Football et Hurricanes, deux jeux s’inspirant sans vergogne de Soccer Kid. Ocean sort Eek the Cat, un jeu basé sur un dessin animé nord-américain qui n’est rien d’autre qu’un reskin de Sleepwalker, ainsi que les adaptations de « Waterworld » et « The Shadow », deux films promis à un grand avenir. Le cas Ocean est emblématique : leurs jeux n’ont pas l’air d’avoir eu un gros succès aux États-Unis, et leur filiale américaine perd de l’argent. Les autres compagnies peuvent s’en tirer si elles visent moins haut et utilisent des thèmes porteurs en Europe, comme le football et la BD franco-belge. Mais dans le numéro 13 de Retro Gamer, Steve Wilcox (Elite Systems) pointe le responsable de leur chute : Sony. Le groupe japonais a en effet approché plusieurs sociétés britanniques pour leur proposer de prendre en charge la distribution européenne de leurs jeux plutôt que de passer par les antennes locales de Nintendo. Le partenariat a fonctionné jusqu’à fin 1994, quand Sony a annoncé qu’en raison des mauvaises perspectives de ventes, ils achèteraient leurs jeux à un prix bien plus bas que prévu. Les chiffres annoncés par Richard Wilcox parlent d’eux-même : 3 millions d’euros de perte pour Elite Systems, 4 millions pour Domark, 15 millions pour Ocean, 30 millions pour U.S. Gold ! Il accuse même Sony d’avoir délibérément torpillé ces sociétés pour préparer la sortie de la PlayStation. On voit mal l’intérêt de nuire à de potentiels partenaires pour leur future console, à moins de vouloir faire de la place pour leurs protégés Psygnosis. Mais quand on sait qu’ils retarderont volontairement la validation d’Alone in the Dark 2 sur PlayStation pour le faire sortir après Resident Evil (cf « Les Dossiers d’Alone in the Dark » de Nicolas Deneschau)… Quoi qu’il en soit, ces éditeurs sont maintenant en difficulté et doivent soit devenir de simples studios (Elite Systems), soit se restructurer et être rachetés (les autres).
Je n’ai évoqué que les États-Unis, mais le livre « Games War » nous apprend qu’au Royaume-Uni, ce n’était pas la joie non plus. Les revendeurs se sont montrés trop optimistes dans leurs commandes pour Noël 1993. Afin de gagner des nouveaux clients, la chaîne de magasins Woolsworth annonce en novembre 1993 une promotion sauvage : la Megadrive passe de 129£ à 99£ (soit tout de même 150$ avec le taux de change de l’époque). Ne voulant pas se faire distancer à l’approche de Noël, plusieurs concurrents suivent, et Nintendo brade son bundle Super Mario All Stars au même prix. Résultat : les marges des revendeurs sont anéanties, et plusieurs enseignes non-spécialisées commencent à se détourner de ces produits. Puis c’est au tour des softs, avec la chaîne de magasins Future Zone qui propose des promotions particulièrement agressives (sa situation financière délicate entraînera l’entrée du groupe américain Electronics Boutique dans son capital en 1995), puis les magasins Virgin s’y mettent, puis Toys R Us et Dixons. Fin 1994, cela aurait atteint un point tel que des petits revendeurs indépendants allaient s’approvisionner en Donkey Kong Country chez Toys R Us plutôt qu’auprès de Nintendo pour avoir une meilleure marge. Cet article de Out of Print Archive nous apprend aussi qu’en 1994, les magazines britanniques dédiés à Sega voient leur ventes diminuer de moitié et disparaissent rapidement, sans même tenir jusqu’à la sortie de la Saturn. Cela bouge aussi chez les constructeurs : dès novembre 1993, Sega ouvre une ligne de production de cartouches au Pays de Galles pour réduire les coûts d’importation, et fin avril 1994, Nick Alexander quitte la direction de Sega Europe, ce qui n’est pas bon signe. Les pertes s’accumulent, et en février 1996, Sega annonce la liquidation de sa filiale commerciale européenne. Du côté de Nintendo, la filiale française, qui accusait deux exercices déficitaires en 1995, est restructurée, ce qui retardera la sortie française de la N64.
.png)
Woolsworth et les marges des revendeurs anglais : allégorie
Il est temps de conclure. Cette crise a été causée par la combinaison de plusieurs facteurs : une baisse des ventes mal anticipée, comme en 1983 et 1989, de nouveaux modèles de consoles se faisaient attendre, et un contexte économique rarement aussi défavorable à l’importation de marchandises japonaises. Les nouvelles consoles déjà disponibles (3DO, CD32, Jaguar) n’ont été d’aucune utilité pour ralentir ce retournement. Mais le marché s’est rétabli en 1996, sans reproduire le scénario désastreux de 1984. Rétrospectivement, on a oublié ou minimisé cette crise (le syndrome « bug de l’an 2000 »), mais les professionnels cragnaient vraiment le pire – faillites en série, désengagement des joueurs, et j’en passe. Aujourd’hui, on peut s’amuser à imaginer des scénarios alternatifs si certains paramètres avaient été différents :
- La PlayStation se plante comme la 3DO faute de jeux intéressants.
- La Saturn sort en 1994 aux USA.
- Nintendo sort sa console six mois plus tôt, mais plus cher, ou six mois plus tard pour laisser le marché agoniser.
- Le dollar reprend des couleurs bien plus tôt (1992, par exemple).
- Sega of America parvient à convaincre la maison-mère de répartir la production du hardware entre le Japon et les États-Unis pour réduire les importations.
- Suivant ce qui ce faisait sur PC avec la dualité disquettes/CD-ROM, Sega of America encourage les éditeurs à sortir une version Mega-CD de tous leurs jeux (avec ou sans contenu supplémentaire) afin de les vendre moins chers que sur cartouche et pousser les ventes du Mega-CD.
- Tom Kalinske annonce le MSX, une extension avec lecteur CD-ROM et puce 3D pour Master System, à destination du marché brésilien (bon, OK, là, c’est n’importe quoi).
Une prochaine fois, on reviendra sur la mère de toutes les crises, celle de 1983, pas du tout sous-estimée celle-là, mais sur laquelle on entend encore trop d’âneries. À suivre, donc…
