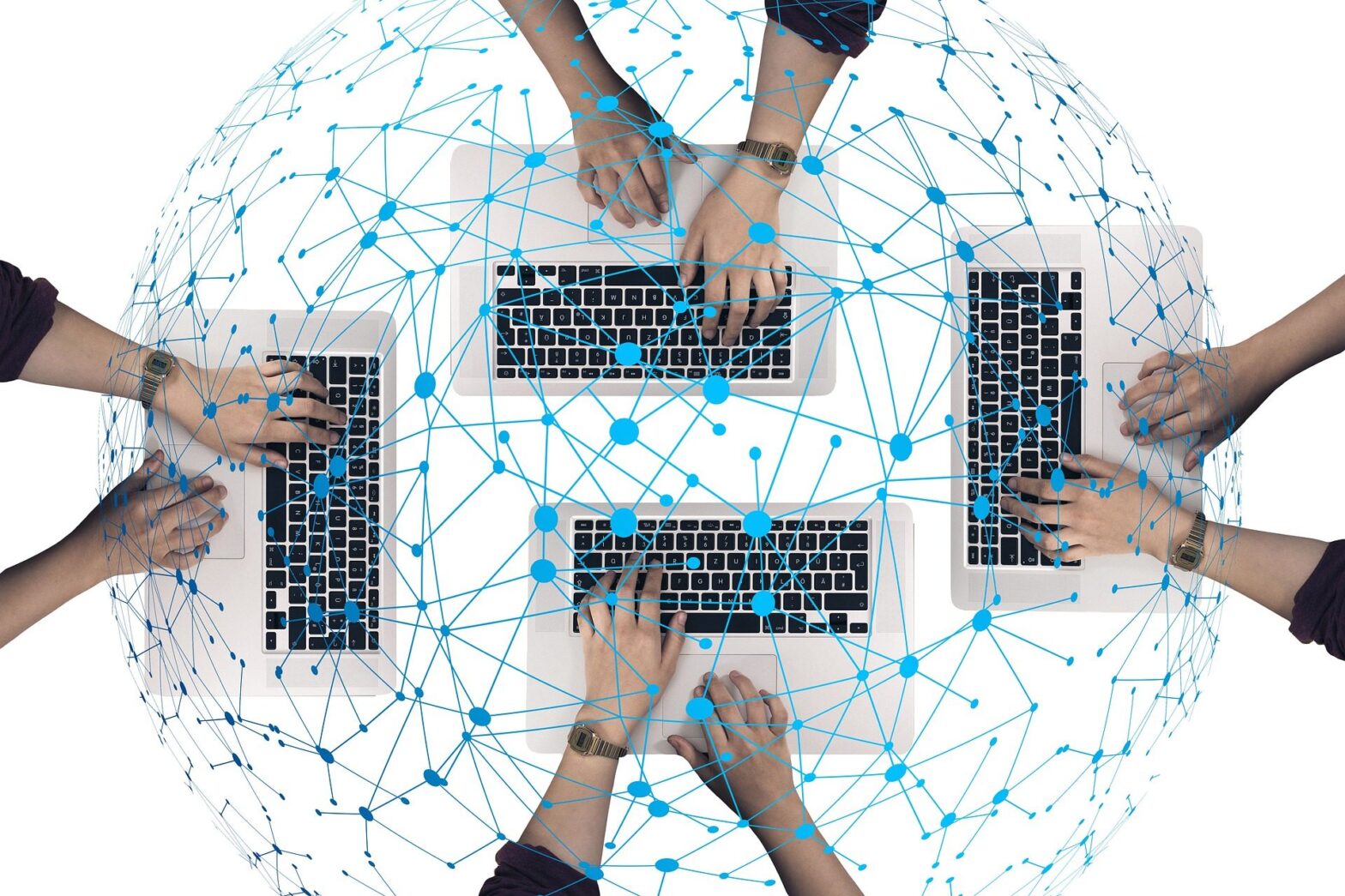Pour mettre fin à la haine en ligne, Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la Transition numérique, a annoncé une mesure coup de poing : une nouvelle peine complémentaire qui consiste bannir pendant six mois les cyberharceleurs des réseaux sociaux. Problème : la mesure serait difficilement applicable et ne permettrait pas de réduire les cas de harcèlement en ligne.
Comment arrêter les auteurs de harcèlement en ligne qui parviennent souvent à échapper à la moindre poursuite ? En les excluant des réseaux sociaux pendant six mois, un « bannissement social 2.0 » proposé par Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, dans son projet de loi visant à sécuriser le numérique. « La mesure frappera les chefs de meute, là où ça fait mal, en les privant de leur caisse de résonance, et en confisquant leur notoriété », explique-t-il chez nos confrères de France 2. Pendant six mois, voire un an en cas de récidive, une personne condamnée pour harcèlement en ligne pourra être exclue des plateformes.
🔴🗣 « Pour les responsables de harcèlement en ligne, nous prévoyons une peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux de 6 mois à 1 an »@jnbarrot, ministre de la transition numérique. #Les4V pic.twitter.com/MTW11rPrXI
— Telematin (@telematin) May 10, 2023
La peine n’existe pas en droit français : elle fait partie de la panoplie de nouvelles mesures présentée en conseil des ministres mercredi 10 mai, destinées à rendre le Web plus sûr. Mais sera-t-elle applicable, et permettra-t-elle de réduire la haine en ligne ? « Au mieux, ça fera peut-être peur aux gros comptes, à des personnes qui sont suivies par énormément de followers, et qui ont tendance à jeter en pâture un ou une internaute à leurs fans, comme ça s’est passé plusieurs fois dans des cas de cyberharcèlement en meute », concède Laure Salmona, co-fondatrice de l’association Féministes contre le cyberharcèlement.
Imposer des règles aux réseaux sociaux : la chasse gardée de la Commission européenne
Mais dans les faits, la mesure « exemplaire » du projet de loi devrait être difficilement applicable. Premier problème : il s’agit d’imposer à des sociétés comme TikTok, Snapchat, Twitter, Instagram ou encore Facebook une nouvelle obligation, celle de fermer des comptes temporairement. Cette nouvelle mesure n’est pas définie par un texte de l’Union européenne, mais par un projet de loi français, destiné à être appliqué seulement dans l’Hexagone.
Pour ces plateformes, « l’État-membre de l’Union européenne qui peut agir est celui dans lequel le réseau social a son établissement – c’est la règle avant l’entrée en vigueur du Digital Services Act (DSA) », le règlement européen qui impose de nouvelles règles aux géants de la tech, précise Alexandre Archambault, avocat spécialiste du numérique. « Or, aucune de ces entreprises n’a son siège social en France. Et avec le DSA, ce type de société est normalement de la compétence de la Commission européenne », ajoute-t-il, soit la chasse gardée de l’exécutif européen. Il est donc fort possible que ce projet reçoive un « avis circonstancié » de Bruxelles. Comprenez : un gros feu rouge.
Le Conseil d’État suggère d’abandonner une partie de la mesure
Deuxième problème : la technique. Le bannissement 2.0 n’est pas seulement une exclusion temporaire, donc une fermeture de compte sur un réseau social. Pendant six mois, la plateforme devra aussi s’assurer que la personne concernée ne crée aucun autre compte. Cette mission serait difficilement réalisable techniquement.
Les cyberharceleurs pourraient en effet, en deux ou trois clics, recréer un compte avec un autre pseudonyme, puisque les réseaux sociaux ne vérifient pas l’identité de leurs utilisateurs. Autre solution évoquée par le ministre : il suffirait de bloquer son adresse IP, un moyen d’identifier un internaute. Mais la personne concernée n’aurait qu’à passer par un VPN ou un smartphone pour obtenir une autre adresse IP et contourner un éventuel blocage. Le Conseil d’État suggère d’ailleurs d’abandonner la mesure qui obligerait les plateformes à surveiller activement toute re-création de compte. « Cette obligation présentée comme une obligation de moyens et qui n’est pas pénalement réprimée ne trouve pas sa place dans le code pénal », écrit la plus haute autorité administrative dans son avis publié mercredi 10 mai.
Seuls 3 % des cas de cyberharcèlement font l’objet de poursuites judiciaires
Autre souci : le bannissement 2.0 serait inadapté à la lutte contre la haine en ligne. En partie parce qu’il s’agit d’une peine complémentaire. Et qui dit peine dit condamnation du cyberharceleur… et donc jugement. Or, seuls 3 % des cas de « violence en ligne » font l’objet de poursuites judiciaires, rapporte Laure Salmona, s’appuyant sur une enquête de novembre 2022 d’Ipsos réalisée auprès de 216 victimes de cyberviolences. Non seulement elle ne serait prononcée que dans de très rares cas, mais elle arriverait des années après le début du cyberharcèlement, le temps que l’affaire soit jugée. Le bannissement sera-t-il encore pertinent à ce moment-là ? Voilà la question que se pose la co-directrice de Féministes contre le cyberharcèlement.
À la place de ce bannissement qui arrive en bout de chaîne, il aurait fallu faire tant d’autres choses, regrette Magali Chavanne, fondatrice de l’association CybHaso. « On n’imagine pas à quel point le parcours d’une victime de harcèlement en ligne est semé d’embuches », explique-t-elle. Et ce dès le début, dès le moment où on commence à être la cible de vague de haine, ou d’un cyberharceleur qui se met à diffuser des photos ou des vidéos intimes. « On ne sait d’abord ni quoi faire, ni vers qui se tourner », résume la bénévole. Il n’existe aujourd’hui aucune plateforme d’information générale à destination des adultes. Les mineurs peuvent, eux, s’adresser au 30 18, mais la majorité des jeunes ne connaissent pas ce numéro, souligne Laure Salmona, dont l’association a mis en place un guide pratique à destination de toutes les victimes de cyberharcèlement.
« Pour une Mila, vous avez 99 gamines à qui la justice dit, vous comprenez, on est saturé »
Un autre obstacle barre la route des victimes : il faut réussir à porter plainte pour déclencher une enquête, expliquent les associations. Une étude d’Ipsos de novembre 2021 portant sur 1 008 Français montre que ce n’est pas chose aisée. Parmi les personnes qui ont souhaité effectuer cette démarche, 67 % d’entre elles ont essuyé un refus et n’ont pas pu porter plainte. Dans une autre étude d’Ipsos de novembre 2022 portant sur 216 victimes de cyberviolences, le chiffre tombe à un tiers des personnes qui ne sont pas parvenus à porter plainte.
Enfin, il faut ensuite attendre que l’enquête avance, « alors que le cyberharcèlement continue, et que les victimes, en majorité des femmes, sont détruites. Les policiers croulent sous les dossiers, il faut continuer à payer un avocat… Souvent, l’investigation n’aboutit pas, car le harceleur se cache derrière un VPN », détaille Magali Chavanne.
« Il y a un véritable sentiment d’impunité parce que pour une Mila – une jeune femme dont les cyberharceleurs ont été condamnés – vous avez 99 autres gamines à qui la justice dit “vous comprenez, on est saturé, on n’a pas les moyens, ça prendra du temps” », confirme Maître Archambault. Au lieu de faire des lois, il faudrait d’abord accorder plus de moyens à la justice française, plaide-t-il : « On ne peut pas annoncer des grandes intentions de lutter contre les agissements malveillants en ligne, tout en continuant à placer notre justice dans un état structurel de clochardisation ».
Miser sur la prévention
Plutôt qu’une mesure en tout bout de chaîne, ou une énième loi, il faudrait d’abord former les policiers et gendarmes et accompagner et soutenir les victimes, listent les associations. Miser sur la prévention dans les établissements scolaires, donner plus de moyens aux infirmières scolaires… Les idées fusent lorsqu’on demande ce qu’il faudrait faire pour mieux lutter contre le cyberharcèlement.
La première d’entre elles : organiser « une grande campagne nationale, comme cela a été fait pour la sécurité routière », soutient Laure Salmona. « Il faut à un moment une volonté politique de mettre de l’argent sur la table. Aujourd’hui, les plateformes numériques ne peuvent pas rester des zones de non-droit. Il faut que les mentalités changent, et le changement, ça prend du temps, ça coûte de l’argent », poursuit-elle, avant d’ajouter : « Il est vraiment temps de s’y mettre ».